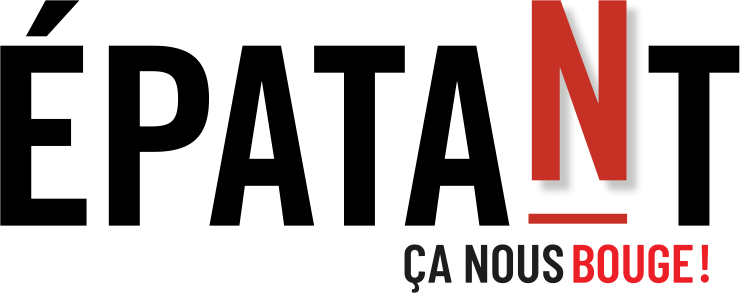Ouverte en 1975, la première boutique Agnès b. située rue du Jour est encore là, immortelle. Quatre ans plus tard est créé le célèbre cardigan pression, pièce iconique, et toujours d’actualité. Aujourd’hui, Agnès Troublé (aka Agnès b.) est connue dans le monde entier et reste l’une des plus grandes figures de la mode de sa génération, mais pas que : elle est aussi devenue une galeriste et mécène essentielle dans le monde de l’art. Rencontre.
Agnès b. est un ovni. Un objet virevoltant non identifié. Elle se lève, revient, repart, allume une cigarette, répond à une question qu’on ne lui a pas posée. Elle mène la danse. Suivre son rythme, c’est perdre le fil. Et l’aiguille aussi. Agnès b. n’est pas une créatrice de mode. « Je déteste ce mot. Je suis styliste, pas “créatrice de mode”». Dans les années 70 et 80, styliste n’était pas un terme désuet. Le coiffeur n’était pas encore devenu « visagiste ». Et le styliste, pas un « fashion designer ». Le mot disait le métier. Point. Sa première boutique, ouverte en 1975, rue du Jour, en face de l’église Saint-Eustache, est toujours là. Dans ses bureaux de la rue Dieu, un capharnaüm organisé tient lieu d’une caverne à idées. Les projets s’étalent, anciens, terminés ou encore au stade de simple ébauche. Là, des écharpes inspirées de celles des supporters de football. Là, un foulard parsemé de photos prises à Versailles, des piles de grosses boîtes dans lesquelles elle cache des objets en vrac. Autour de ses doigts, par exemple, s’enroulent des bagues en laiton que l’on confond avec des morceaux de feuilles d’aluminium culinaires. Dans l’ensemble des bureaux, des “points d’ironie” (comme des points d’interrogation à l’envers indiquant qu’une phrase doit être prise au second degré) – sa marque de fabrique – sont étalés sur tous les murs, les fenêtres, les t-shirts. Agnès ajoute simplement : « on devrait les rajouter sur les claviers ».
Agnès b. a cette diction bien particulière, qui pourrait être celle d’une petite fille. Mais sous ses airs de jeune première, on saisit rapidement le côté rock’n’roll qui bout en elle. Honnête, elle ne passe pas par quatre chemins. Lorsqu’on demande la première décision qu’elle prendrait si elle était au pouvoir, elle répond du tac au tac « Légaliser la weed. », puis après une demi-seconde de réflexion : « et puis, éradiquer la cocaïne. »
Elle digresse beaucoup, s’évade, nous emmène là où elle le souhaite. Elle est déterminée, sait ce qu’elle veut, sait où elle va. Impossible d’avoir la moindre prise sur elle. Et puis, elle est hyperactive. Fait mille choses à la fois. A son nez dans des tonnes de projets différents.
Peut-être que le lien entre tout ce qu’elle entreprend est le partage. Ce qui est inspirant chez elle, c’est son courage. Celui de dire, de répéter, inlassablement : les riches doivent partager. Et celui d’aider, d’accompagner, encore et toujours. C’est ce qui semble régir sa vie : partout où elle va, Agnès aide les autres.
Elle donne à de nombreuses associations et fondations mais elle en a aussi créées, comme Tara Océan, aujourd’hui reconnue d’utilité publique, consacrée à l’anticipation du changement climatique. Le projet, commencé il y a quinze ans avec son fils Etienne Bourgois, naît avec l’achat du Seamaster, bâteau sur lequel s’était fait tuer Peter Blake (artiste britannique). « On l’a acheté à nous deux, j’ai récemment donné ma part à Tara, créée il y a deux ans. Il y a douze personnes à bord, l’équipage, le capitaine, des scientifiques et deux artistes qu’on invite avec un comité de sélection. On a beaucoup de demandes pour partir à bord ! » Avec Tara, ils envoient des échantillons dans le monde entier afin de connaître la mer plus en profondeur, de “révéler le peuple invisible de l’océan”. En estimant l’ampleur de la biodiversité sous-marine, la manière dont elle est organisée et l’étude de sa potentielle sensibilité aux interventions humaines, Tara permet d’anticiper sa future protection.
Elle dit avoir conscience de ce que c’est que de ne rien avoir. Mariée à dix-sept ans sans avoir fait d’études, elle s’est retrouvée quatre ans plus tard seule avec ses jumeaux de deux ans. « J’ai beau venir d’une famille bourgeoise, être née à Versailles dans une famille très cultivée, durant cette période, je vivais avec le minimum. Mes parents ne m’ont jamais donné un centime. J’ai tout vendu parce que je ne savais pas comment on allait manger le lendemain. J’ai conscience de ce que c’est de ne pas avoir d’argent ! » Elle le clame haut et fort : pour elle, il est normal et même essentiel d’aider les autres. Elle ajoute très vite : « et de payer ses impôts en France ! ». Au fil des interviews, Agnès persiste et signe : c’est primordial. Elle s’offusque en disant : « Les gens riches qui prennent des avocats pour savoir comment ne pas payer d’impôts, ça me révulse. Que vont-ils faire de cet argent ? Je ne comprends pas ».
« Les gens riches qui prennent des avocats pour savoir comment ne pas payer d’impôts, ça me révulse. Que vont-ils faire de cet argent ? »
Cette aide, c’est aussi et surtout celle qu’elle a apportée à de nombreux artistes. Au sein de son fonds de dotation « Agnès Troublé dite agnès b. » créé en 2009 pour structurer les actions de mécénat, tout un budget est réservé à l’art et la culture. Ce fonds permet donc à beaucoup d’avoir une visibilité et une diffusion. Agnès organise par exemple des expositions collectives au sein de ses galeries, dans des salons d’art contemporain ou même dans les boutiques.
Le grand mystère de la réussite de la marque, c’est qu’elle n’a jamais fait de publicité. Comment a-t-elle donc pu se faire remarquer puis connaître ? Comment est-elle devenue une telle institution sans avoir jamais dépensé un centime dans la moindre campagne ? Agnès affirme modestement qu’elle ne serait rien sans l’immense soutien de la presse. « Je n’ai jamais voulu faire de publicité parce que je lisais Debord, les situationnistes et ils étaient contre. La pub est une manipulation. J’étais d’ailleurs à Médiapart hier et ils parlaient de la manière dont Bolloré s’empare des médias, c’est terrifiant, ils se mettent à manipuler, eux aussi… »
Régulièrement, elle se lève, pour aller chercher une énième cigarette. Elle s’interrompt, rejoint son bureau, enferme dans une petite boîte son mégot et pioche une clope toute neuve. Parfois, elle ressemble à une ado un peu rebelle, sapée tout en noir. On pourrait croire qu’elle n’a pas d’âge, à l’image de ses vêtements. Ce qui les différencie des milliers d’autres marques, c’est précisément ça : ils sont intemporels. « J’ai toujours fait des vêtements qu’on peut garder longtemps, qui ne sont pas datés, confirme Agnès. Je n’aime pas la mode, je n’arrête pas de le dire. Je ne suis jamais rentrée dans aucune boutique, je ne sais pas ce que font les autres. » Elle s’inspire de tout autour d’elle, de la nature, de l’art, des graffs. Mais certainement pas des autres.
« Je n’aime pas la mode, je n’arrête pas de le dire. Je ne suis jamais rentrée dans aucune boutique, je ne sais pas ce que font les autres. »
À l’heure où la fast fashion reste monstrueusement dominante, où les vêtements sont produits – et détruits, parfois même enterrés dans des déserts – en masse, Agnès b., en créant ces pièces “en dehors de toute mode” et non-datées, en produisant de façon locale avec de bonnes matières, tente de rendre cette industrie souvent diabolique la plus éthique possible. « On fait une braderie avec les surplus pour tout le personnel, et le reste ne va que pour de bonnes œuvres. On n’a jamais rien détruit. »
Mais Agnès b., c’est aussi le nom qu’on voit écrit dans le générique de films cultes, de Mulholland Drive (David Lynch) à Pulp Fiction (Tarantino). Quand on la lance sur le sujet, elle raconte une anecdote : « Tarantino avait envoyé son habilleuse dans la boutique Agnes b. à Beverly Hills pour Reservoir Dogs puis Pulp Fiction et on a retrouvé le mot de Travolta dix ans après qui me remerciait pour la veste que je lui avais refaite. C’était la veste noire avec le col en cuir de Pulp. Il l’avait gardée, usée puis dix ans après me demandait de la refaire. »
La dernière grande dame de la mode est partout à la fois. Elle a autant habillé les artistes les plus célèbres (Lynch, Gaspard Noé…), qu’acheté et exposé les œuvres d’inconnus au bataillon : « J’ai connu plein d’artistes dans la rue. Je vois ce qui me saute aux yeux. » Cet œil-là lui a permis de révéler au grand public, grâce à sa galerie (ouverte en 1983) de très grands noms de la scène artistique actuelle, comme Martin Parr ou Nan Goldin (photographes). Après la mode, l’associatif, l’art… who’s next ?
Par Léontine Behaeghel