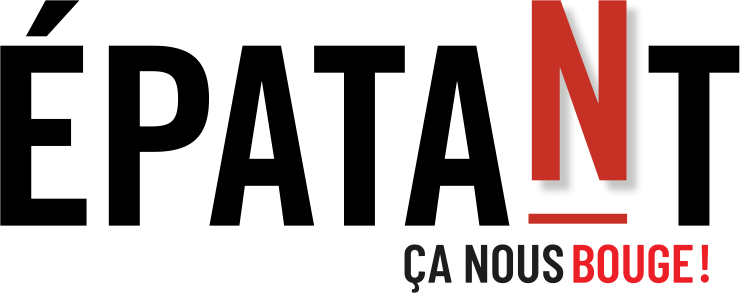À l’affiche du film Les Miens (Roschdy Zem) et de la série Les Papillons noirs (Olivier Abbou), Sami Bouajila poursuit sa carrière avec la même authenticité qu’à ses débuts. Un parcours qui mêle théâtre, cinéma, films d’auteur et films d’action… Pourtant, après trente ans entre planches et plateaux, le comédien doublement césarisé ne cesse de se réinventer. Conversation impromptue.
Épatant. Vous avez le rôle principal dans le nouveau film de Roschy Zem, Les Miens, sorti en novembre dernier. Dans le film, votre personnage a un accident cérébral qui le rend exécrable. Cette histoire est inspirée de celle du frère du réalisateur. S’est-il calqué sur sa vraie personnalité pour créer votre personnage ?
Sami Bouajila. Oui, complètement. Tout ce qu’on voit dans le film est totalement inspiré de la famille de Roschdy et du traumatisme qu’a vécu son frère. Je le connais d’ailleurs de longue date mais lorsque Roschdy m’a proposé le rôle l’année dernière, je ne savais même pas qu’il avait vécu tout ça.
Roschdy Zem a dit dans une interview : « Mon héros est diagnostiqué anormal, mais est-ce que ce n’est pas nous qui sommes anormaux en apprenant à travestir la réalité, à tricher pour demeurer comme les autres ? ». Que pensez-vous du comportement post-accident de votre personnage qui, soudain, fait preuve d’un trop plein d’honnêteté ?
La remarque que fait Roschdy est très judicieuse. Nous sommes conditionnés par des codes de vie, des codes de conduite mais nous rendent-ils réellement service ? Au sein de la société et pour que tout le monde puisse s’entendre, il faut effectivement avoir un dialogue, des mœurs, des traits de politesse communs. Mais on sait bien qu’il est salvateur aussi parfois de pouvoir se libérer, transgresser et dire haut et fort ce qu’on pense. C’est ce qui arrive au personnage et au frère de Roschdy. Au départ, Moustafa était quelqu’un de plutôt inhibé et le trauma l’a rendu exubérant et sans filtre. Je pense que ce qu’il a traversé lui a permis de passer un cap.
Votre vie privée semble assez distincte de votre vie professionnelle. C’est important pour vous de préserver votre famille, vos enfants du « star system » ?
Évidemment. C’est un leurre le star system. Être acteur, pour moi, c’est un métier. Même si j’ai une certaine reconnaissance, je reste qui je suis, je garde les pieds sur terre et je ne change pas. C’est l’éducation que j’ai reçue et je me fais un devoir et un plaisir de la transmettre à mes enfants. Je veux qu’ils vivent leurs rêves sans oublier qui ils sont et d’où ils viennent.
Vous vous êtes formé au Conservatoire de Grenoble et à la Comédie de Saint-Étienne. Vous y revenez régulièrement à ces débuts au théâtre. Comment définiriez-vous ce besoin de faire des allers-retours entre plateaux et planches ?
C’est au théâtre que j’ai appris mon métier, mais j’ai fait ma carrière au cinéma. Quand j’ai l’opportunité de retourner au théâtre, je le fais avec plaisir, mais je reste parfois de longues périodes sans monter sur scène. J’aime le théâtre de compagnie, j’aime jouer un texte qui m’interpelle, dans lequel je me sens concerné. Et j’aime être rassuré par un metteur en scène, qu’il y ait une cohérence dans le fait de faire un voyage avec lui.
Comment avez-vous découvert que vous vouliez faire du théâtre ?
Je faisais mon service militaire et j’avais du temps pour moi le soir. Je me suis inscrit dans un atelier théâtre d’abord. Miraculeusement, je ne suis pas tombé sur un atelier conceptuel et bizarre. Cet atelier était génial, il était un peu à l’image d’une école connue à l’époque à Paris, l’école Lecoq, qui délivrait un enseignement essentiellement corporel. J’aurais aimé y être. Le professeur de mon atelier en sortait et moi qui venais des quartiers, qui avais de l’énergie à revendre, j’y trouvais ma place. Et dans son regard, je comprenais que ça avait un sens. Il voyait que j’avais des choses à dire et à raconter. Ensuite, quand je suis allé au conservatoire puis à l’École Nationale, ça s’est confirmé. C’est là que j’ai décidé de m’investir corps et âme.
Vous avez joué récemment dans Disgrâce au théâtre d’Antibes. Vous deviez d’ailleurs reprendre le spectacle au théâtre du Rond-Point mais ça ne s’est finalement pas fait…
Non, je ne le reprends pas mais je fais un seul en scène au théâtre de l’Œuvre en septembre 2023 qui s’appelle Un Prince. C’est un texte d’Émilie Frèche. C’est l’histoire d’un homme dont la mémoire se confond avec celle de son fils. Passionnant. Je l’ai créé à Antibes, c’était fantastique.
Comment êtes-vous passé du théâtre au cinéma ?
Aux journées de sorties de l’École Nationale, j’ai été repéré par un agent qui m’a fait passer un casting, j’ai décroché le rôle principal et j’ai fait ce film, puis d’autres, puis je suis retourné au théâtre pour jouer Roméo et Juliette. Ensuite, le cinéma a répondu présent. Je n’ai cessé de faire des rencontres avec des réalisateurs, des films, des projets et j’ai continué. Même si c’était un peu un hasard au départ.
Quelle est la différence entre les deux, au niveau du jeu ?
L’intention est la même : il faut trouver l’authenticité du personnage. Il faut donc découvrir sa psychologie. Après, c’est l’outil qui est différent. Au cinéma, le son et l’image viennent à vous. Ils impriment votre âme. Tandis qu’au théâtre, c’est le regard du spectateur qui vient à vous. Une des différences fondamentales est la suivante : au théâtre, on est sans filet. C’est un art éphémère, chaque représentation est différente de la veille et sera différente le lendemain. On ne va que dans un sens, on ne peut pas couper, on ne peut pas reprendre. Cela dit, même au cinéma, quand on dit qu’on reprend, il y a malgré tout toujours quelques petites nuances. Au fond, qu’est-ce que la bonne prise ?
Peut-on le sentir, en tant qu’acteur, quand c’est la bonne prise ?
On sent quelque chose, mais ce n’est jamais nous qui tranchons. Pour ma part, je cherche juste à être authentique à chaque fois. Et puis au bout d’un moment, à m’amuser. D’ailleurs, c’est quand on oublie tout et qu’on s’amuse qu’il se passe quelque chose. Il faut se débrider.

À l’inverse, vous est-il déjà arrivé de souffrir sur un tournage ?
Oui, bien sûr. Enfin, d’en chier. J’ai déjà fait des quarante-cinq prises, par exemple. Parfois, c’est compliqué, mais comme pour n’importe quel métier.
Abdellatif Kechiche, par exemple, avec qui vous avez travaillé, a la réputation d’être particulièrement difficile…
Kechiche est quelqu’un d’exigeant, dont l’exigence est d’aller créer un cinéma qui sort de ce qu’on a sûrement l’habitude de voir ou de faire. Il cherche une émotion qui n’est pas fabriquée. C’est ça qui est difficile !
Justement, où se situe la limite entre la réalité et le jeu ?
C’est précisément là que ça devient intéressant. Et c’est là que Kechiche commence à travailler. C’est quelque part par là qu’il souhaite mettre sa caméra. Et quand, même en essayant de vous oublier, vous tentez de faire ce qu’il attend, il peut venir et vous demander d’arrêter de jouer. Puis quand l’accident se produit et que ça vous a échappé, on passe à autre chose. Aller chercher loin, se faire du mal pour atteindre un endroit dans le jeu ne doit pas nécessairement être associé à la souffrance. C’est peut-être justement en se mettant en danger – ce qui peut solliciter un malaise ou une sortie de sa zone de confort – que l’on sort de soi ce qu’il y a de plus intéressant. Il y a une certaine poésie dans la captation de ce qui nous échappe. C’est sûrement aussi dans l’accident que se trouve la beauté du jeu.
Vous avez déjà dit que vous remerciez le cinéma d’auteur de vous avoir laissé votre chance. De quelle façon le racisme a-t-il freiné votre carrière ?
Lorsque Roschdy Zem, moi et pleins d’autres démarrions, la force du cinéma français était vraiment son cinéma d’auteur. C’était un vrai vivier avec une grande dynamique, ça foisonnait. À ce moment-là, dans le cinéma classique ou traditionnel, il n’y avait peut-être pas beaucoup de place pour des gens comme nous. Mais on a semé une graine qui a porté ses fruits. Pour ne citer que Roschdy et moi, à travers ce parcours, on a su s’épanouir et devenir également créateurs.
Vous avez un peu plus de trente ans de cinéma derrière vous, vous avez travaillé avec d’immenses réalisateurs comme Kechiche ou Desplechin. Quel regard portez-vous sur votre carrière ?
Je pense qu’elle est à mon image. Il y a tout de même de la fierté et surtout tellement de plaisir et de joie ! J’aime ma vie. Je ne suis pas – ou en tout cas plus – un artiste torturé. (Rires).
Aimeriez-vous réaliser un film ?
J’adorerais. Mais j’ai déjà eu des tentatives qui n’ont jamais abouti donc je m’interdis d’en parler avant que quelque chose de concret ne se réalise.