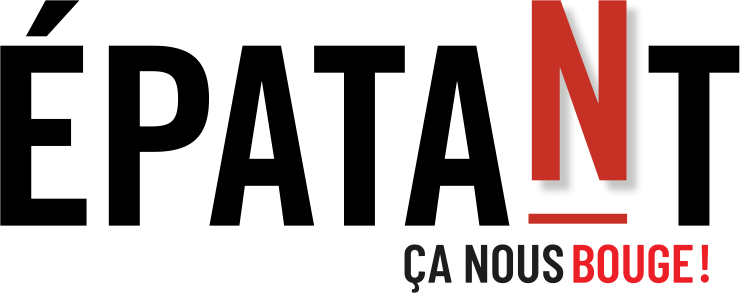Poète, réalisateur et militant écologiste, Cyril Dion a mis en exergue ses valeurs à travers le livre La nuit est une page blanche aux côtés du duo Stéphane Guiran et Katarzyna Kot. À l’intérieur, des photographies et dessins des artistes s’entrelacent aux écrits de Cyril Dion qui nous transportent aux pieds du glacier Vatnajökull en Islande tout en émouvant. Rencontre avec un écrivain qui met en avant la beauté de la nature à travers son art.
Tobias Claiser – Quel est le meilleur moyen pour sensibiliser à la cause environnementale entre l’art et les actions concrètes ?
Cyril Dion – Malheureusement, ce sont les feux, les canicules et les sécheresses qui sensibilisent le plus les personnes au changement climatique. L’expérience et la tangibilité des évènements marquent profondément les personnes. Le péril écologique est intimement lié à une crise de la sensibilité. On est de plus en plus indifférents au sort des forêts, des glaciers et des océans. Si on ne retrouve pas cette capacité à éprouver de la peine, de la douleur, de la colère, du ravissement ou encore de l’attachement, alors il y a peu de chance qu’on se mobilise intérieurement pour protéger le monde vivant. Je trouve que les artistes ont une responsabilité et un pouvoir considérable en ces temps sombres. C’est une des raisons pour lesquelles je fais de l’art et plus particulièrement du cinéma. Lorsque j’ai vu le travail de Stéphane et Katarzyna, c’était pour moi une occasion de faire dialoguer des approches artistiques variées et des différentes sensibilités pour apporter notre petite pierre à la démarche écologique. Toutes les initiatives prises au cours de ma vie, jusqu’à aujourd’hui, ont eu un impact juste en dessous des catastrophes climatiques. Le cinéma a la faculté de toucher un large public en donnant l’illusion d’expérimenter, même si on fait déjà l’expérience de l’art au moment même. Il a aussi cette capacité à faire fonctionner l’intellect, en nous identifiant à des personnages, éveiller nos sens grâce au visuel et à l’audio, et susciter l’imaginaire… Tout cela mène à une expérience riche et permet au cinéma d’être un art-total.

Daphnée Cataldo – Certaines personnes, qui s’intéressent à votre art, semblent déjà sensibilisées à la cause environnementale. Que se passe-t-il pour les autres n’ayant pas encore cette prise de conscience ?
C D – Tout dépend. Demain, un documentaire qui a fait 1 200 000 d’entrées au cinéma, va chercher un public qui va bien au-delà de celui qui regarde ce genre de film habituellement. Cela concerne tant le cinéma que la littérature. On s’intéresse à une œuvre parce qu’on suit le travail de la personne qui crée, des proches nous le recommandent ou on est attiré par des pubs dans le métro. Il y a une volonté de partager une expérience et cela tisse un lien. J’ai été épaté lorsque des personnes me disaient avoir vu le film cinq fois, mais pour différentes occasions : le voir avec sa grand-mère, ses collègues… Le but était finalement de se donner la possibilité d’avoir une conversation fructueuse et constructive. Cette expérience a une dimension collective. Regarder une comédie seul chez soi n’a pas le même impact que de la regarder dans un cinéma où 500 personnes rient. On ne la regarde pas de la même façon, on ne vit pas la même expérience. C’est le même principe pour les personnes qui vont voir un documentaire au cinéma, et c’est sans compter le moment où on sort de la salle.
T C – Est-ce qu’à travers vos œuvres et vos engagements, vous trouvez un sens à votre vie ?
C D – J’essaye de donner du sens à ma vie de façon générale. Il y a des jours où j’y arrive mieux que d’autres. Je donne du sens au fait de ne pas rester extérieur à ce qu’il se passe autour de moi. Il y a, selon moi, une forme d’absurdité à voir un problème et ne rien faire. C’est peut-être lié à mon anxiété. C’est une forme d’anticipation négative du futur, même s’il n’y a pas toujours de fondement. Dans le cadre de la pragmatique climatique, il y a des raisons d’être anxieux. Une des seules façons de combattre l’anxiété est d’essayer d’y faire quelque chose et ne pas me sentir impuissant.
D C – Est-ce que ce côté anxieux vous rend pessimiste quant à l’avenir climatique ou avez-vous un minimum d’espoir ?
C D – De mon point de vue, être optimiste et avoir de l’espoir sont deux choses bien différentes. L’adage populaire dit « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » et on est obligé d’avoir de l’espoir, autrement la vie n’en est que davantage désespérante. Il y a un moment où on se dit « Mais à quoi sert tout ça ? Je sais qu’un jour je disparaîtrai. Peut-être que tout ce que je pense, tout ce que j’entreprends va s’arrêter… Donc pourquoi le vivre ? ». Sauf que c’est le propre de la condition humaine : trouver du sens, avoir de l’espoir et nourrir une vitalité chaque jour. Il en va de même pour l’urgence climatique. Si on parvient à se lever chaque matin en sachant qu’on est destiné à une fin, on peut se lever chaque matin en se disant que l’avenir sera peut-être compliqué, parce que le climat va se dérégler et que des espèces vont disparaître… Puis il y a une forme de naïveté dans l’optimisme car il n’y a aucune bonne raison pour que l’avenir se passe bien. Cela ne cesse de se dégrader. Je suis engagé sur le sujet depuis plus de quinze ans, et tous les propos d’antan se réalise, mais rien ne change. C’est désespérant. Il n’y a aucune raison d’être optimiste. En revanche, je nourris de l’espoir dans la capacité des individus à réagir. Certains font des choses extraordinaires et sont capables de trouver des solutions. Il y aura sans doute un moment où la situation sera tellement grave que les consciences ne se réveilleront qu’à ce moment-là. Cependant, il ne faut pas oublier que le changement climatique est irréversible. Aujourd’hui, on est à +1,2°C et il est impossible de revenir en arrière. Tout ce qui va désormais se dégrader, à l’échelle de notre vie, le restera pour toujours.

Daphnée – Y a-t-il une inquiétude pour les générations à venir ?
C D – C’est une situation qui est déjà très compliquée actuellement. Il ne s’agit pas de repousser le problème à plus tard. Dans trente ans, j’aurai 75 ans et je serai bien plus vulnérable. C’est pour cela qu’il est important de vivre en y donnant le plus de sens possible. Il faut réveiller ce qu’il y a de plus ardent en nous.
D C – A travers le livre La nuit est une page blanche et l’exposition à la Galerie Pierre-Alain Challier, Stéphane Guiran et Katarzyna Kot semblent avoir vécu une expérience indescriptible sur le glacier Vatnajökull en Islande. Encouragez-vous les personnes à vivre ce genre d’aventure ?
C D – La vraie invitation est d’aller à la rencontre des « Grands Vivants » comme l’appellent Stéphane et Katarzyna. Lors de la réalisation d’Animal, Baptiste Morizot, un philosophe du vivant, me disait : « Les oiseaux dans l’arbre à côté de chez toi sont tes voisins, mais tu ne les connais pas. Tu es incapable de savoir leur espèce ou de reconnaître leur chant… Es-tu même capable de connaître l’arbre sur lequel ils sont perchés ? » Il s’agit d’être présent, écouter, comprendre et être attentif en allant dans une forêt, une montagne ou au bord de l’océan. L’art sert à ça. La démarche de Stéphane et Katarzyna ne se résume pas à aller en Islande pour voir des volcans, c’est une véritable qualité d’attention qui s’est instaurée pour comprendre et capturer cet « Être-lieu » pour reprendre le terme de Katarzyna. Cette démarche est possible partout. C’est cette énergie-là qui peut nous permettre de combattre l’inéluctable et opposer des dynamiques de vie à des dynamiques de mort, qui sont l’effondrement de la biodiversité, le dérèglement, du climat… Si on se plonge dans cette présence au monde, il y a quelque chose de profondément rassérénant puisque la vie est toujours présente et on peut y participer. Cela renvoie à la pratique de la méditation, un point sur lequel on se rejoint avec Stéphane et Katarzyna. Cela fait environ vingt ans que je pratique cette discipline et cela permet d’être plus attentif à ce qui nous entoure. Pour ma part, les poèmes ramènent également à cela. J’ai beaucoup travaillé sur la base des haïkus, ces poèmes japonais de trois vers issus des moines, qui permettent un satori, c’est-à-dire un moment d’éveil et une captation de l’instant présent. Historiquement, les moines écrivaient les haïkus et c’était une pratique du zen. C’est une façon de contrecarrer ce sentiment d’impuissance et de retrouver une forme de présence au monde qui ne dépend pas des projections que l’on peut faire du futur.
Daphnée Cataldo & Tobias Claiser