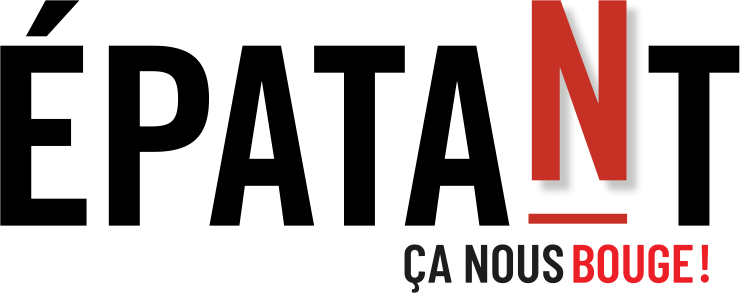Rebecca Zlotowski attire l’attention dès Belle Épine en 2010, film de fin d’études qui s’est frayé un chemin jusqu’aux Césars. Avec Grand Central (2013) puis Planétarium (2016), la réalisatrice prend place comme une cinéaste contemporaine importante, tout en prenant les armes contre le sexisme, en tant que pionnière du Collectif 50/50 qui lutte pour la parité dans l’industrie cinématographique française. En 2019, elle réalise en parallèle de la série politique Les Sauvages, le film Une fille facile. Cette chronique d’un été avec Zahia Dehar, primée par la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes, pose un regard affiné et pertinent sur des questions résolument contemporaines. Portrait d’une cinéaste auto-proclamée “pure jouisseuse totalement mélancolique”, qui fait des films comme on s’aime, à la vie à la mort.
Février, fin de matinée, quartier latin. On sonne à “zlotowski”, écrit dans une police noire épaisse, sans majuscule, sans sérif. Une voix vive et chaude nous indique le chemin. Face à l’entrée, un mur recouvert de chapeaux de paille qui se chevauchent joyeusement sur des crochets, portant l’odeur d’étés passés. Dans la pièce, fleurs séchées et crânes décoratifs, autant de memento mori qui entourent le bureau où écrit Rebecca Zlotowski. Deux fenêtres donnent sur un jardinet calme. Elle nous prépare un thé. Sur les étagères, des œuvres majeures de la littérature française s’entremêlent aux DVD.
La sonnette de l’entrée est à son image, la cinéaste ne fait ni dans les fioritures ni dans la prétention. L’humour est aiguisé, fin et direct. À s’y méprendre, son style titille quelque chose de gothique : toute de noir vêtue, un noeud en velours noir tient ses cheveux de jais, au doigt une bague montée d’un crâne. Mais ce dernier est bleu pastel, et des baskets aux couleurs acidulées nous donnent des premiers indices que la cinéaste est traversée de pulsions duelles, avec un goût pour le contraste.
Affectée dès sa jeunesse par la perte de sa mère, Rebecca Zlotowski se dit obsédée par le trajet invisible de la mort. « Elle est morte brutalement d’un AVC, devant moi, je me disais “voilà un corps qui présente tous les symptômes de la vie, telle qu’elle doit continuer dans sa fluidité, mais en fait la mort est déjà là.” J’ai été beaucoup plus habitée que ce que je pensais par cette idée-là. » Les films, eux, ne trompent pas, ils racontent, parfois malgré elle, ce que la cinéaste découvre d’elle-même au fil des années, ses propres secrets qu’elle avoue ne pas tous connaître.
« Le cinéma est une affaire de nostalgie, mais aussi de libido, d’érotisme. C’est pour moi ce qui est le plus emballant au cinéma, ces deux registres, et c’est ça qui me donne le sentiment d’être très en vie. ». Dans cette vie, elle se sent chez elle : « Je suis une hédoniste, une pure jouisseuse, mais souvent mélancolique. »
« Le cinéma est une affaire de nostalgie, mais aussi de libido, d’érotisme. »
Un bref trajet au sein de sa filmographie illustre ces sentiments qui l’habitent. Dans Belle épine (2010) le danger vivifiant du circuit de moto se veut combler agressivement le vide de la disparition d’une mère, omniprésente dans son absence. Dans Grand Central (2013), le trajet invisible de la radioactivité euphorise la passion d’une histoire amoureuse. Dans Planétarium (2016), la menace collective de la Seconde Guerre mondiale plane sur une vive fièvre festive. Dans Une Fille facile (2019), il s’agit de vivre, jouir à tout prix des corps et des sens, mais dans une profonde vacuité amoureuse, presque morbide dans sa vanité.
« C’est un lieu commun de dire qu’on fait un film en réaction au précédent, mais c’est vrai », nous dit Rebecca Zlotowski à propos d’Une fille facile. Après Planétarium, film aux multiples couches complexes et à la production difficile, elle réalise ce film d’été, de coquillages et crustacés. « Planétarium est complètement névrosé, je me suis un peu détendue. J’allais mieux, et j’ai balancé du côté libido avec Une fille facile. Je l’ai écrit très rapidement, j’ai eu envie de faire un film comme on part en vacances. »
C’est l’occasion de revenir sur la rencontre avec Zahia Dehar, qui incarne Sofia, jeune femme aux charmes tactiques qui dessinent son mode de vie. Le film à été imaginé, pensé, écrit pour elle. « C’est drôle, j’ai dîné avec Zahia hier. C’est une actrice et jeune femme que j’adore. Une fille facile, c’est une robe taillée sur mesure autour d’elle. De la haute couture, pour parler comme elle. J’ai été séduite par Zahia, parce que je ne m’attendais pas à être émue par elle. Alors j’ai écrit le film pour elle, pour sa prosodie, sa manière de marcher, de parler, son corps. Elle a été à l’origine du film. Ce qui m’a séduite d’abord c’est sa façon de parler, je la trouvais hyper élégante, très années 60. »
La rencontre s’est faite sur Instagram, « c’est vraiment le tinder de la mise en scène… » Cet Instagram, généreux, où Zahia Dehar se dévoile sans pudeur. « C’est un peu notre Emily Ratajkowski à nous. Elle a un côté bimbo, matérialiste, qui n’a pas peur de revendiquer son plaisir, son désir de choses parfois artificielles. Elle est très éloignée de moi sur ces points. D’ailleurs, autour de moi les gens n’étaient pas prêts. Ils ont suspecté du cynisme, n’ont pas saisi que je pouvais avoir de la sororité envers elle. Et après ils ont vu le film, et ils ont compris. »
Chez Rebecca Zlotowski, les films naissent alors plutôt d’idées que d’images. « Je n’ai pas une image qui me hanterait, comme certains cinéastes. Chez moi, ça vient d’un projet. Je suis scolaire, ça vient d’une construction mentale. Et ça découle de ma formation. La pensée me mène à l’émotion, qui me mène à l’image. Et donc j’ai besoin de savoir où je vais dès le départ. Je suis mon plan à la ligne, c’est théorique, ce qui n’est pas toujours valorisé aujourd’hui, où on voue un culte à l’artiste hanté par des visions. »
On le sent dans l’écriture de ses films, travaillée au mot près. Les idées se traitent dans un premier temps par ces mots, dans la langue, avant de les porter à l’image. D’ailleurs, la cinéaste considère la langue comme son outil le plus précieux : « au fond, mon trésor, le seul savoir que je possède, c’est la maîtrise de la langue. Enfin, maîtrise, ce n’est pas sûr, mais c’est en tout cas ma formation. »
« LE SEUL SAVOIR QUE JE POSSÈDE, C’EST LA MAÎTRISE DE LA LANGUE. »
On revient sur cette formation. Avec quatre (bientôt cinq) long-métrages et une série diffusée sur Canal, tous soutenus par la critique, la réalisatrice est inscrite au feutre indélébile dans le paysage du cinéma français. Pourtant, au départ, elle ne se destinait pas à une vie d’artiste. « Je suis issue d’une famille à capital culturel, mais assez modeste d’un point de vue des ressources. Une espèce de climat circulait sur mon adolescence, qui dictait qu’il fallait trouver un métier, très solide, salarié… À peu près tout l’opposé de la liberté qu’ont les cinéastes à l’idée de devenir réalisateur, qui est un métier aléatoire, difficile, mystérieux. Et puis je ne connaissais personne dans le cinéma, ni de gens qui vivaient de leur art. »
Bien que l’appétence pour le cinéma soit déjà là, elle ne s’y consacre pleinement qu’après un “long détour universitaire”, de soldat méritocratique traversant avec brio toutes les étapes de l’école de la République : classe préparatoire, intégration à l’ENS, réussite à l’agrégation de lettres. Avec une modestie sincère, elle nous confie, « Je n’ai pas de mérite, ça me coûtait peu, j’aimais les études et j’étais douée pour ça, j’aimais les classes, étudier… J’ai beaucoup aimé ces années-là. » Elle nous relate, avec une auto-dérision entre l’exaspération et l’attendrissement, que son fantasme secret était d’enseigner le cinéma à la fac, et d’être scénariste à côté, idéalement (“le rêve absolu !”) la compagne d’un réalisateur génial, dont elle écrirait les chefs-d’œuvres… Impossible pour elle à cette époque de concevoir qu’elle deviendrait, quinze ans plus tard, une tête de proue du Collectif 50/50 pour la parité dans le cinéma français.
L’étape décisive se joue entre les murs de la Fémis, prestigieuse école de cinéma au concours notoirement ardu, qu’elle réussit du premier coup. Suivant une intuition profonde, Rebecca Zlotowski quitte le parcours tout tracé de l’Education Nationale pour poursuivre son désir de cinéma. « Je me suis dit : si je ne démissionne pas je vais me réveiller dans quinze ans, heureuse du métier que je fais, mais ce n’était pas celui que je voulais faire. »
Et après tout, nourrir le cinéma, n’est-ce pas aussi servir le pays ? Décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres, Rebecca Zlotowski s’inscrit pleinement dans le cinéma français, qu’elle reconnaît comme une chance. « En France nous sommes extrêmement libres dans ce métier, j’ai conscience d’avoir une place privilégiée dans cette industrie. C’est une chance. On est dans une industrie qui nous permet de faire des films même quand on fait peu d’entrées. Il y a cette part militante chez moi qui est de reconnaître le privilège que ça représente de faire des films en France et donc d’essayer de le défendre à plein d’endroits, et ça ne veut pas dire de l’enfermer. »
De fait, cette ouverture se retrouve dans les modes de diffusion de ses derniers projets. On pense à Une Fille facile (2019), qui, après un passage par le Festival de Cannes, est diffusée sur Netflix monde, et Les Sauvages (2019), série télévisée diffusée sur Canal+. La cinéaste reconnaît avec plaisir l’audience à laquelle ce circuit lui donne accès. « J’ai peu d’audience, mes films sont très confidentiels. » La série lui a aussi donné le sentiment d’être réalisatrice : « Je me suis sentie aussi technicienne, j’ai acheté des vêtements techniques, des pantalons Quechua. C’est la même chose pour les quelques publicités que j’ai réalisées. Je disais que je le faisais pour l’argent, mais c’est faux. Ca me plaisait d’avoir des nouvelles de la technique, pouvoir utiliser des gadgets, des grues auxquelles je n’ai pas accès normalement. »
Même aujourd’hui, de temps en temps, elle hallucine de faire ce métier, elle se dit que ce n’était pas prévu. Et elle s’empresse d’ajouter, « mais j’hallucine aussi de pouvoir être libre ! C’était contraignant les études, c’était contraignant cette angoisse de devoir gagner sa vie, d’être indépendant, d’être autonome. Et en fait, à partir du moment où j’y ai accédé, tout m’a paru une espèce de plaisir immense ! »
Plutôt tournée vers la suite, ce qui s’accorde avec son optimisme résolu, elle nous avoue qu’elle ne revoit pas ses films. Mais il arrive parfois qu’une scène lui vienne en tête, pour laquelle elle se dit « ah tiens, je m’y reconnais pleinement, je m’y plais. Je me sens à l’aise là-dedans ». Chez Rebecca Zlotowski, le cinéma est comme une grande maison où circulent, du cœur de ses pièces et jusque dans ses recoins, les forces invisibles et contradictoires qui animent nos vies.
Par Lucie Buclet