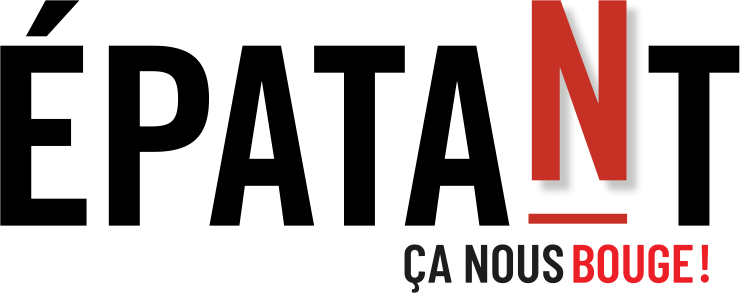Rien ne semble pouvoir semer d’embûches la route artistique déjà bien tracée de la jeune autrice franco-vietnamienne Line Papin. Pas même les épreuves de la vie. De deux drames intimes liés à la maternité, elle se relève et propose son cinquième roman : Une vie possible. Entre l’autofiction et l’essai, ce récit poignant relate son expérience et ses interrogations face à la naissance, à l’essence de la femme, à l’élan féministe qui la gagne. Entretien avec Line Papin sur fond de recul majeur du droit des femmes aux Etats-Unis.
Preniez-vous la mesure du tabou qui existe autour des interruptions volontaires et involontaires de grossesse avant d’aborder le sujet dans votre dernier roman ?
Quand le livre était tout juste imprimé et pas encore disponible au grand public, on me disait, en interne : “quel courage”. Je ne comprenais pas. Le courage de quoi ? D’écrire et de décrire ça ? L’avortement est pourtant légal en France. Alors où est le courage ? Je pensais que c’était une cause bien plus acquise. Une femme sur trois avorte – mais personne ne le dit. Aujourd’hui je constate combien ces sujets sont encore tabous à la réaction de certains : crispés, gênés ou carrément outrés. Mais moins l’on en parle, plus nos droits peuvent reculer.
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » disait l’auteur Mark Twain. Si vous aviez été consciente du courage que cela exigeait de vous, auriez-vous pu sortir ce roman ?
Ce livre, je l’aurais écrit de toute manière. Parce que je l’ai fait pour moi, pour comprendre ce qui m’arrivait. Pour interroger ce silence si étrange autour de ces événements. Tant de femmes se retrouvent seules. Et il n’est pas évident d’en parler. Je reçois beaucoup de retours sur les réseaux sociaux ou par lettres manuscrites, des réactions très positives de femmes de tous âges, très émues… Elles partagent avec moi leurs expériences personnelles. C’est beau car j’ai l’impression que le livre leur est utile. Quand on fait une fausse couche, les gens ne savent pas tellement ce qu’on vit. Ils se disent « ce n’est pas grave, elle en aura un autre », ou ils se retrouvent mal à l’aise et maladroits, sans savoir quels mots réconfortants avoir. Ce roman, je le conçois comme une fenêtre vers l’intérieur.
Savez-vous si les hommes s’emparent de votre récit ? Et comment ?
Le livre s’adresse aussi aux hommes. Ils sont toujours exclus de cette affaire de maternité, et même de contraception – alors que cela les concerne. On est bien deux, au départ. Beaucoup d’hommes sont d’ailleurs curieux et désireux de comprendre, de savoir. Et puis, il y a une autre dimension dans le livre qui est celle de la naissance. À cet endroit, nous nous rejoignons tous, puisque nous sommes tous nés. Une vie possible pose la question de notre venue au monde, de notre place dans le monde. C’est une interrogation qui ne laisse personne à la porte : quel que soit notre sexe, nous sommes là et nous devons faire face à l’existant. En contraste, se pose la question inverse : qu’est-ce que ne pas naître ? Le livre interroge vraiment cet élément : vie. Trop souvent, on prend les choses pour acquises et l’on oublie de songer à ce qu’est le vivant, à sa vérité. Quand on expérimente dans son corps une interruption de grossesse, il se passe quelque chose de très organique. Comme le dit Annie Ernaux, c’est l’expérience de la vie et de la mort en même temps.
Y a-t-il eu des écrits qui vous ont inspirée pour l’écriture de ce livre ?
C’est précisément parce qu’il n’y en avait pas, ou trop peu, que j’ai eu envie de l’écrire. Avant de vivre ces interruptions de grossesse, je ne m’intéressais pas vraiment à la question. Une fois ces événements expérimentés, j’ai cherché des échos dans les livres des autres, pour me sentir moins seule. J’ai surtout trouvé des essais, formidables par ailleurs : ceux de Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Simone Veil… Les écrits de Gisèle Halimi sont peut-être ceux qui se rapprochent le plus du récit, car elle y met beaucoup de son histoire personnelle. Mais en littérature, le sujet demeure rarement abordé. J’ai bien sûr lu L’événement d’Annie Ernaux – dont le contexte est celui d’une autre époque. Le hasard a fait que le film d’Audrey Diwan, tiré de ce roman, est sorti au moment où j’ai rendu mon manuscrit. Ce film m’a bouleversée car, malgré le fait qu’il se déroule à une époque où l’avortement était illégal, j’ai reconnu les sentiments de solitude et le fait d’être pressée par le temps, oppressée même. C’est la solitude et la douleur d’une jeune femme.
Cette adaptation à l’écran de L’événement n’est d’ailleurs pas passée inaperçue dans le milieu du cinéma en remportant le convoité Lion d’or à la Mostra de Venise en 2021. Toutefois, alors qu’elle était pré-sélectionnée pour représenter la France aux Oscars, on lui a préféré un autre film…
Au vu de ce qu’il se passe actuellement aux États-Unis avec la révocation du droit à l’avortement par la Cour Suprême, ce n’est, hélas, pas très étonnant. C’est regrettable : cela aurait opposé à cette décision politique une forme de contre-poids. On en a besoin.
Comment expliquez-vous que le corps des femmes soit à ce point politique ?
Le corps des femmes a toujours été un sujet politique, bien avant que les femmes aient le droit de vote. La politique s’en est mêlée car ces enfants auxquels les femmes donnent naissance ne sont autres que des citoyens en devenir. Il faut d’ailleurs remarquer que, selon les périodes politiques, on est plus ou moins libres. En Chine, il y a la politique de l’enfant unique. À l’inverse, sous Vichy, la propagande incitait vivement à fonder une famille nombreuse : l’heure était à la création de soldats, de contribuables, de travailleurs, de consommateurs. Il fallait repeupler le pays, d’où l’interdiction d’avorter et même de diffuser des informations sur la contraception. En ce moment, on traverse une période de crise sanitaire, économique et politique, et l’on constate que le droit des femmes recule. Comme toujours, ce sont elles les premières à pâtir d’un climat d’instabilité. À ce propos, Simone de Beauvoir nous mettait en garde : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. »

Paradoxalement, aux États-Unis notamment, le mouvement #MeToo a été entendu, accueilli, voire soutenu. L’énorme pas en arrière de la Cour Suprême des États-Unis ne serait-il pas une façon de faire payer ce pas en avant du combat féministe ?
En tout cas, ce paradoxe de deux mouvements antagonistes est évident. Cette forte régression américaine est désolante. Ce qui est frappant, c’est qu’au moment-même ou les américains reviennent sur le droit à l’avortement, ils étendent le port d’armes. Ceux qui se qualifient de “pro vie” nous disent : « vous tuez des gens ». Mais que font donc les armes à qui ils donnent plus de liberté qu’aux femmes ? Tout cela n’a pas de sens.
Annie Ernaux est-elle une figure d’exemple pour vous ?
Oui. Je l’ai rencontrée à l’occasion d’un entretien croisé en 2016, lors de la sortie de mon premier roman L’éveil. L’histoire est celle d’une jeune fille qui justement s’éveille à l’amour, à la sexualité, à la mort… Autant de thèmes qui concordaient parfaitement avec Mémoire de fille d’Annie Ernaux. Nous correspondons un peu depuis. Je lui ai envoyé Une vie possible alors qu’il n’était encore qu’un document PDF sur mon ordinateur. Comme un écho lointain à L’événement. Nous avons évoqué ensemble la préoccupante actualité du droit à l’avortement. Elle pense qu’en France le droit à l’IVG devrait être inscrit dans la Constitution. Je trouve ça très inspirant de voir des femmes comme elle qui, à cet âge, se battent encore, sont présentes, font porter leurs voix… Nous avons tant à apprendre d’elles.

Quel thème de prédilection retrouve-t-on au fil de vos romans ?
Sûrement le corps, et tout ce qui passe à travers lui : la naissance, la mort, l’amour, le fait de grandir, de vieillir, de souffrir, de maigrir, de grossir, d’enfanter d’autres naissances, d’autres morts et d’autres corps. Que fait-on de son corps, quel rapport entretenons-nous avec lui, comment change-t-il… C’est la matière de tout.
Vous réduit-on parfois à votre âge et/ou à votre sexe ?
Avant, souvent. On me désignait volontiers comme la (plus) jeune romancière. C’était la plupart du temps une manière un peu maladroite de me mettre en avant, il n’y avait rien de méchant à ça. À vrai dire, ça ne m’a jamais vraiment atteint, parce que je ne me sens pas spécialement jeune. Je suis sûrement ce qu’on appelle une “vieille âme”. Mais c’est vrai que, en tant que jeune femme, sur mes premiers plateaux télé, des « oh qu’elle est mignonne, qu’elle est jeune » fusaient parfois… Je m’enfermais moi-même dans ce rôle de la toute jeune et mignonne écrivaine. Or je passais à côté du propos – parce que mes livres ne sont pas “mignons et jeunes”. J’écris à partir de choses difficiles que j’ai vécues.
Un auteur qui vous accompagne dans des moments de doute ?
Récemment, je me suis réfugiée dans les pages d’Imre Kertész, auteur notamment d’Être sans destin. Déporté et survivant d’Auschwitz, Prix Nobel de littérature, il a écrit Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas. Évidemment, le titre m’a interpellée. Kertész s’interroge sur pourquoi il ne peut plus donner naissance après avoir “vécu la mort”. C’est très très beau. Puissant. À lire absolument.
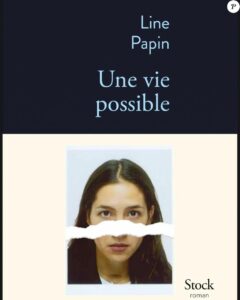
Une vie possible, Editions Stock, 250 pages, 20 euros.
Par Dobra Szwinkel